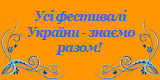Тексти шкільної літератури
Франція. Lettres persanes
Montesquieu Lettres persanes
MONTESQUIEU
ŒUVRES COMPLÈTES
ÉDITION ÉDOUARD LABOULAYE
GARNIER FRÈRES, 1875
LETTRES PERSANES
PRÉFACE DE L’ÉDITEUR
C’est en 1721 que la première édition des Lettres persanes parut en deux volumes in-12 sous la rubrique d’Amsterdam et de Cologne. Le nom de l’auteur n’était pas indiqué ; les noms des deux libraires, Pierre Brunel d’Amsterdam, Pierre Marteau de Cologne, sont des pseudonymes. Ce mystère était d’usage au XVIIe et au XVIIIe siècle. Un Français qui disait librement son avis sur la religion et le gouvernement ne se souciait point d’avoir affaire aux ministres, au parlement, à la Sorbonne. Pour l’écrivain et pour l’imprimeur il y allait de la Bastille, et au besoin de la corde ; c’était trop de dangers à la fois.1 Du reste, sous la régence l’ancienne rigueur s’était adoucie ; les mœurs étaient devenues plus tolérantes que les lois. Pourvu que l’auteur fit paraître son œuvre à l’étranger et ne livrât pas son nom à la curiosité publique, il pouvait impunément recevoir les compliments de ceux qui l’auraient jeté dans un cachot, s’il avait eu l’audace d’imprimer à Paris ce qu’il publiait à Amsterdam.
Les Lettres persanes eurent un grand succès ; on en fit trois ou quatre éditions la même année.2 Comment en eût-il été autrement ? tout était piquant dans cette publication, le nom de l’auteur, la forme et le fond du livre.
L’auteur, dont on se répétait le nom à l’oreille, n’était rien de moins qu’un président à mortier du parlement de Bordeaux, un grave magistrat qui, en dehors de sa profession, ne s’était fait connaitre que par son goût pour les sciences naturelles. On conçoit qu’il ne voulût point livrer inutilement sa personne à la malignité publique ; il avait l’honneur de la robe à soutenir. Mais il avait soin de se laisser deviner dans l’introduction de son livre. « Si l’on vient à savoir mon nom, écrivait-il, dès ce moment je me tais... C’est assez des défauts de l’ouvrage sans que je présente encore à la critique ceux de ma personne. Si l’on savait qui je suis, on dirait : « Son livre jure avec son caractère ; il devrait employer son temps à quelque chose de mieux. » Les critiques ne manquent jamais ces sortes de réflexions parce qu’on peut les faire sans essayer beaucoup son esprit. »
La forme, nouvelle alors, ne manquait pas d’agrément. On n’était pas encore habitué à cette fiction d’étrangers, jugeant la France à la mesure des idées ou des préjugés de leur pays. Dans ce contraste des mœurs et des opinions, il y a toujours quelque chose de saisissant ; le seul défaut de cette fable ingénieuse, c’est qu’on en a trop usé.
Voltaire a dit que le Siamois des Amusements serieux et comiques de Dufresny avait inspiré Montesquieu. J’en doute. Le Siamois de Dufresny est un personnage de convention, qui n’a ni caractère, ni idées à lui. C’est, comme le dit l’auteur lui-même, un voyageur abstrait ; il n’est là que pour remplacer Dufresny, en ne le laissant pas parler seul tout le long de son livre. Voici du reste un passage de cette satire parisienne aujourd’hui oubliée quoiqu’elle ne manque pas d’esprit ; on verra quelle distance il y a entre la création de Montesquieu et celle de son prétendu modèle.
« Paris est un monde entier ; on y découvre chaque jour plus de pays nouveaux et de singularités surprenantes que dans tout le reste de la terre ; on distingue, dans les Parisiens seuls, tant de nations, de mœurs et de coutumes différentes, que les habitants même en ignorent la moitié. Imaginez-vous donc combien un Siamois y trouverait de nouveautés surprenantes. Quel amusement ne serait-ce point pour lui d’examiner avec des yeux de voyageur toutes les particularités de cette grande ville ? Il me prend envie de faire voyager ce Siamois avec moi ; ses idées bizarres et figurées me fourniront sans doute de la variété et peut-être de l’agrément.
« Je vais donc prendre le génie d’un voyageur siamois, qui n’aurait jamais rien vu de semblable à ce qui se passe dans Paris ; nous verrons un peu de quelle manière il sera frappé de certaines choses que les préjugés de l’habitude nous font paraitre raisonnables et naturelles.
« Pour diversifier le style de ma relation, tantôt je ferai parler mon voyageur, tantôt je parlerai moi-même ; j’entrerai dans les idées abstraites d’un Siamois ; je le ferai entrer dans les nôtres ; enfin supposant que nous nous entendons tous deux à demi-mot, je donnerai l’essor à mon imagination et à la sienne.
« Je suppose donc que mon Siamois tombe des nues, et qu’il se trouve dans le milieu de cette cité vaste et tumultueuse, où le repos et le silence ont peine à régner pendant la nuit même. D’abord le chaos bruyant de la rue Saint-Honoré l’étourdit et l’épouvante ; la tête lui tourne, etc.3 »
Si le Siamois de Dufresny n’a pas été d’un grand secours à l’auteur des Lettres persanes, peut-être en est-il autrement d’un livre qui aujourd’hui n’est connu que de quelques amateurs ; je veux parler de l’Espion dans les cours des princes chrétiens, du P. Marana. C’est une espèce de journal, dans lequel un soi-disant Turc, agent du Grand Seigneur, rapporte et juge les événements qui se passent dans le monde, durant une grande partie du XVIIe siècle. Cet ouvrage avait eu assez de succès pour qu’en 1720 et en 1730 les éditions hollandaises des Lettres persanes ajoutassent au-dessous du titre : Dans le goût de l’Espion dans les cours, comme un moyen de recommander l’œuvre nouvelle à la faveur du public.
A vrai dire, ce sont là des détails de peu d’importance, bons tout au plus à amuser les curieux. Ce qui fait le mérite de ces fictions transparentes, ce n’est point le cadre, qui est banal, c’est le tableau. Montesquieu a eu vingt imitateurs ; il a plu des lettres turques, des lettres juives, des lettres chinoises, etc. ; qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
Si l’on peut disputer pour savoir à qui Montesquieu a emprunté la forme de son livre, il faut du moins reconnaître que le fonds n’appartient et ne pouvait appartenir qu’à lui seul.4 Ce mélange de sérieux et de comique, ces discussions qui agitent les plus grands problèmes de la religion et de la politique, et qui sont placées au milieu de tableaux de mœurs et de peintures qui ne rappellent que trop la liberté de la régence, tout cela c’est le génie de Montesquieu. Son livre, c’est lui.
Je ne connais pas d’écrivain qui ait moins varié que Montesquieu. « L’esprit que j’ai est un moule, disait-il lui-même ; on n’en tire jamais que les mêmes portraits. » Si je ne craignais l’apparence même d’un paradoxe, j’oserais dire qu’en toute sa vie il n’a fait qu’un seul livre sous des titres différents. Les lettres persanes sur les Troglodytes, sur la tolérance, sur les peines, sur le droit des gens, sur les diverses formes de gouvernement, ne sont que des chapitres détachés de l’Esprit des lois. En revanche, il ne serait pas difficile de rencontrer dans l’Esprit des lois de véritables lettres persanes. Qu’on lise, par exemple, les réflexions d’un gentilhomme sur l’esprit général de la nation française,5 les plaisanteries sur le sérail du roi de Maroc, les prétendues raisons qui en Turquie amènent la clôture des femmes,6 les éternelles allusions aux usages d’Orient qui débordent dans ce grand ouvrage ; on y retrouvera le ton et l’esprit d’Usbek, beaucoup plus que la gravité du législateur. Dans les Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains, Montesquieu a toujours été sérieux ; dans le Temple de Gnide, il n’a été que galant ; mais chacun de ces deux écrits ne donne que la moitié de cet esprit original. Il n’est tout entier, et au même degré, que dans les Lettres persanes et dans l’Esprit des lois.
Le succès de tout chef-d’œuvre fait naître des imitateurs. « Les Lettres persanes, nous dit Montesquieu, eurent un débit si prodigieux que les libraires mirent tout en usage pour en avoir des suites. Ils allaient tirer par la manche tous ceux qu’ils rencontraient : Monsieur, disaient-ils, faites-moi des lettres persanes. » En France on publia des Lettres turques, œuvre anonyme de Saint-Foix,7 que les libraires étrangers ne se firent aucun scrupule de joindre à l’édition des Lettres persanes de 1744. En Angleterre, il parut de Nouvelles Lettres persanes traduites en français, dès l’année 1735, et portant pour épigraphe :
« Non ita certandi cupidus, quam propter amorem Quod te imitari aveo. »
C’est une satire des mœurs anglaises faite par une main peu légère. Du reste, toutes ces imitations, qui amusent les contemporains, n’ont pour effet que de faire sentir par comparaison la différence qui sépare un grand peintre d’un copiste ou d’un barbouilleur. On peut surprendre les procédés d’un artiste, et en reproduire la manière ; on n’imite pas le génie.
Si dans la république des lettres on accueillit avec faveur l’écrivain hardi qui débutait par un coup de maitre, il n’en fut pas de même de ce qu’on appelle aujourd’hui le monde officiel. Si faciles que fussent les mœurs et si libres que fussent les salons de Paris, cette liberté était plus apparente que réelle ; la cour et les ministres avaient peu de goût pour les téméraires qui osaient toucher aux préjugés établis. Un gouvernement absolu n’entend point raillerie. Montesquieu ne fut pas longtemps à s’en apercevoir ; c’est lui-même qui nous l’apprend.
« En entrant dans le monde, nous dit-il, on m’annonça comme un homme d’esprit, et je reçus un accueil assez favorable des gens en place ; mais lorsque par le succès des Lettres persanes, j’eus peut-être prouvé que j’en avais, et que j’eus obtenu quelque estime du public, celle des gens en place se refroidit ; j’essuyai mille dégoûts. Comptez qu’intérieurement blessés de la réputation d’un homme célêlèbre, c’est pour s’en venger qu’ils l’humilient, et qu’il faut soi-même mériter beaucoup d’éloges pour supporter patiemment l’éloge d’autrui.8 »
Aussitôt après la publication des Lettres persanes, Montesquieu vint à Paris pour y jouir de sa réputation. Il trouvait que dans la grande ville la société était plus aimable qu’à la cour, encore bien qu’elle fût composée des mêmes personnes, par la raison, disait-il, qu’on intriguait à Versailles et qu’on s’amusait à Paris.9 C’est là qu’il se lia avec M. de Maurepas et le comte de Caylus. On prétend même qu’il fut un des collaborateurs des Étrennes de la Saint-Jean, livre plus grossier qu’ingénieux.10 Reçu chez Mme de Tencin, vivant familièrement avec les gens de lettres, on commença à parler de lui pour l’Académie. Le Temple de Gnide, composé pour plaire à une princesse du sang, Mlle de Clermont, lui valut des amitiés puissantes, auxquelles on n’avait rien à refuser. Il se présenta, dit-on, à l’Académie en 1725 et fut élu.11 Fontenelle, alors directeur de la compagnie, avait déjà écrit son discours, et l’avait remis au récipiendaire, lorsqu’on fit valoir un article des statuts, article encore en vigueur aujourd’hui, qui ne permet d’élire que des membres résidant à Paris. L’élection ne fut pas validée. Montesquieu, qui n’avait qu’un goût médiocre pour la magistrature, vendit sa charge l’année suivante ; il s’établit à Paris, et devint l’hôte assidu de la marquise de Lambert, femme d’esprit fort répandue, et dans le salon de laquelle on préparait, dit-on, les candidatures académiques. Semblable en ce point au bon roi Numa, l’Académie française a toujours une Égérie ; c’est dans ces belles mains qu’elle remet le dépôt de sa souveraineté.
En 1727, à la mort de M. de Sacy, traducteur de Pline le jeune, Montesquieu se présenta de nouveau à l’Académie. Il était soutenu par l’abbé Mongault, ancien précepteur du duc d’Orléans, et, à ce titre, fort influent dans la compagnie. L’élection allait de soi, le président n’avait pas de concurrent,12 quand tout à coup on rencontra une opposition imprévue. Il ne faut pas oublier qu’au XVIIIe siècle, on n’entrait à l’Académie qu’avec l’agrément du roi, et qu’en 1727 le premier ministre était un cardinal. Ce cardinal, il est vrai, était Fleury, qu’on ne pouvait accuser d’une sévérité outrée ; mais il y avait dans les Lettres persanes des traits d’une telle hardiesse contre le pape, les croyances catholiques y étaient si peu ménagées, l’ancien gouvernement y était si maltraité, qu’on ne doit pas s’étonner qu’en un temps où l’Académie était dans la main du prince, un évêque premier ministre hésitât à laisser entrer parmi les quarante l’auteur d’un livre aussi compromettant.
Montesquieu parvint cependant à tourner cette difficulté ; il finit par obtenir l’agrément du cardinal. Par quel moyen ? A ce sujet nous avons des versions différentes ; c’est peut-être ici le lieu d’éclaircir ce point assez obscur de l’histoire littéraire.
Voyons d’abord ce que nous dit l’avocat Mathieu Marais. Candidat in petto du président Bouhier, Marais eut un moment l’espoir de prendre à l’Académie la place qu’on refusait à Montesquieu. Il avait tout intérêt à se bien renseigner, et de plus c’est un curieux qui court après tous les bavardages de la ville, on peut avoir confiance en lui. Pourquoi le président Bouhier préférait-il un avocat obscur au président de Montesquieu ? C’est ce que nous ignorons. Jalousie de métier peut-être, ou rivalité de bel esprit ?
Voici les lettres de Marais au président :
« Paris, 3 novembre 1727.
« Vous allez être occupé à une élection à l’Académie : M. de Sacy est mort... On parle de lui faire succéder M. le président de Montesquieu, qui a certainement beaucoup d’esprit et de mérite, duquel vous jugerez mieux que moi, puisque vous allez en être juge.13 »
« Paris, 26 novembre 1727.
« M. de Montesquieu n’est pas encore nommé. On lui dit : Si vous avez fait les Lettres persanes, il y en a une contre le corps de l’Académie et ses membres.14 Si vous ne les avez pas faites, qu’avez-vous fait ?15 »
L’objection n’est pas sérieuse. De tout temps on a raillé l’Académie quand on n’en était pas et de tout temps la compagnie s’est vengée des mauvais plaisants en les faisant académiciens. Il en est des bons mots contre l’Académie comme des épigrammes contre le mariage ; ce sont des péchés de jeunesse dont on fait pénitence dans ses vieux jours.
Mais voici qui mérite attention :
« Paris, 17 décembre 1727.
« M. le président de Montesquieu a remercié l’Académie le jour même qu’elle était assemblée pour l’élire.16 C’est M. le maréchal d’Estrées qui a apporte le remercîment. Je sais certainement qu’il a été tracassé pour les Lettres persanes, que le cardinal a dit qu’il y avait dans ce livre des satires contre le gouvernement passé et la régence, que cela marquait un cœur et un esprit de révolte, qu’il y avait aussi de certaines libertés contre la religion et les mœurs, et qu’il fallait désavouer ce livre. Le pauvre père n’a pu désavouer ses enfants, quoique anonymes ; ils lui tendaient leurs petits bras persans, et il leur a sacrifié l’Académie. Il faut donc chercher un autre sujet académique, on parle de l’abbé de Rothelin, et peut-être de M. le garde des sceaux.17 »
« Paris, 22 décembre 1727.
« On m’a assuré que le président de Montesquieu est rentré à l’Académie ; je ne sais par quelle porte.18 »
« Paris, 23 décembre 1727.
« Je ne sais pas encore la porte par où M. le président de Montesquieu est rentré ; mais il est rentré. Aurait-il désavoué ses enfants, et ma figure des petits bras persans ne serait-elle qu’une figure ? Que ne ferait-on point pour être d’un corps où vous êtes ?19 »
« Paris, 29 décembre 1727.
« Je ne sais point encore comment les portes fermées se sont rouvertes ; on aura peut-être abjuré les Lettres après les avoir avouées, sauf à abjurer l’abjuration entre amis, et combien de peines cela n’aura-t-il point données ?20 »
Vingt-huit ans plus tard, au lendemain de la mort de Montesquieu, Maupertuis, qui avait été le correspondant et l’ami de l’auteur des Lettres persanes, son confrère à l’Académie française et à l’Académie de Berlin, Maupertuis raconte les événements de la candidature de 1727, presque dans les mêmes termes que Marais. Le cardinal Fleury exigeait un désaveu. Écoutons l’éloge lu dans l’assemblée publique de l’Académie royale de Berlin, le 5 juin 1755.
Середня оцінка :

0 коментарів :
Залишити коментар :


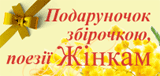

Найважливіше
з теорії детективу!
Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com
ОГОЛОШЕННЯ
До уваги передплатників!
Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!
Передплатити журнали можна:
на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;
за телефоном:
(044) 454-12-80;
у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ
«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»
(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!
Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.
Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.
Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.
Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").