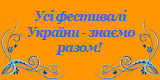Тексти шкільної літератури
Франція. Claudine à l’école
Willy et Colette
Claudine à l’école
Préambule
À l’âge de 20 ans, en 1893, Colette épouse Henri Gauthier Villars, dit Willy, don Juan scandaleux de la Belle Époque. Ce dernier l’introduit dans les milieux « mondains » et l’entraîne dans une vie de bohème. Au bout de quelques temps, Willy se lance dans la littérature en faisant travailler une troupe de nègres comme Debussy ou Fauré pour des chroniques musicales et va demander à sa femme de lui écrire un livre de souvenirs d'enfance.
C'est ainsi qu'en 1900, Claudine à l'écoleparaît sous la signature de Willy, celui-ci prétendant avoir reçu le manuscrit d'une inconnue, créant ainsi la légende de la fameuse Claudine.
Devant le succès, Willy pousse sa femme à écrire 3 suites – Claudine à Paris1901, Claudine en ménage1902, Claudine s'en va1903 – assorties d'un volume intitulé Minne(1904) et des Égarements de Minne(1905).
En 1906, Colette se sépare de Willy.
Ainsi, bien que l’auteur indiqué sur la jaquette de ce livre, soit Willy et Colette, c’est bien sûr Colette, seule, qui l’a écrit.
Chapitre 1
Je m’appelle Claudine, j’habite Montigny ; j’y suis née en 1884 ; probablement je n’y mourrai pas. Mon Manuel de géographie départementale s’exprime ainsi : « Montigny-en-Fresnois, jolie petite ville de 1.950 habitants, construite en amphithéâtre sur la Thaize ; on y admire une tour sarrasine bien conservée... » Moi, ça ne me dit rien du tout, ces descriptions-là ! D’abord, il n’y a pas de Thaize ; je sais bien qu’elle est censée traverser des prés au-dessous du passage à niveau ; mais en aucune saison vous n’y trouveriez de quoi laver les pattes d’un moineau. Montigny construit « en amphithéâtre » ? Non, je ne le vois pas ainsi ; à ma manière, c’est des maisons qui dégringolent, depuis le haut de la colline jusqu’en bas de la vallée ; ça s’étage en escalier au-dessous d’un gros château, rebâti sous Louis XV et déjà plus délabré que la tour sarrasine, basse, toute gainée de lierre, qui s’effrite par en haut un petit peu chaque jour. C’est un village, et pas une ville : les rues, grâce au Ciel, ne sont pas pavées ; les averses y roulent en petits torrents, secs au bout de deux heures ; c’est un village, pas très joli même, et que pourtant j’adore.
Le charme, le délice de ce pays fait de collines et de vallées si étroites que quelques-unes sont des ravins, c’est les bois, les bois profonds et envahisseurs, qui moutonnent et ondulent jusque là-bas, aussi loin qu’on peut voir... Des prés verts les trouent par places, de petites cultures aussi, pas grand-chose, les bois superbes dévorant tout. De sorte que cette belle contrée est affreusement pauvre, avec ses quelques fermes disséminées, peu nombreuses, juste ce qu’il faut de toits rouges pour faire valoir le vert velouté des bois.
Chers bois ! Je les connais tous ; je les ai battus si souvent. Il y a les bois taillis, des arbustes qui vous agrippent méchamment la figure au passage, ceux-là sont pleins de soleil, de fraises, de muguet, et aussi de serpents. J’y ai tressailli de frayeurs suffocantes à voir glisser devant mes pieds ces atroces petits corps lisses et froids ; vingt fois je me suis arrêtée, haletante, en trouvant sous ma main, près de la « passerose », une couleuvre bien sage, roulée en colimaçon régulièrement, sa tête en dessus, ses petits yeux dorés me regardant ; ce n’était pas dangereux, mais quelles terreurs ! Tant pis, je finis toujours par y retourner seule ou avec des camarades ; plutôt seule, parce que ces petites grandes filles m’agacent, ça a peur de se déchirer aux ronces, ça a peur des petites bêtes, des chenilles velues et de araignées des bruyères, si jolies, rondes et roses comme des perles, ça crie, c’est fatigué – insupportables enfin.
Et puis il y a mes préférés, les grands bois qui ont seize et vingt ans, ça me saigne le cœur d’en voir couper un ; pas broussailleux, ceux-là, des arbres comme des colonnes, des sentiers étroits, où il fait presque nuit à midi, où la voix et les pas sonnent d’une façon inquiétante. Dieu, que je les aime ! Je m’y sens tellement seule, les yeux perdus loin entre les arbres, dans le jour vert et mystérieux, à la fois délicieusement tranquille et un peu anxieuse, à cause de la solitude et de l’obscurité vague... Pas de petites bêtes, dans ces grands bois, ni de hautes herbes, un sol battu, tour à tour sec, sonore, ou mou à cause des sources ; des lapins à derrière blanc les traversent ; des chevreuils peureux dont on ne fait que deviner le passage, tant ils courent vite ; de grands faisans lourds, rouges, dorés, des sangliers (je n’en ai pas vu) ; des loups – j’en ai entendu un, au commencement de l’hiver, pendant que je ramassais des faînes, ces bonnes petites faînes huileuses qui grattent la gorge et font tousser. Quelquefois des pluies d’orage vous surprennent dans ces grands bois-là ; on se blottit sous un chêne plus épais que les autres, et, sans rien dire, on écoute la pluie crépiter là-haut comme sur un toit, bien à l’abri, pour ne sortir de ces profondeurs que tout éblouie et dépaysée, mal à l’aise au grand jour.
Et les sapinières ! Peu profondes, elles, et peu mystérieuses, je les aime pour leur odeur, pour les bruyères roses et violettes qui poussent dessous, et pour leur chant sous le vent. Avant d’y arriver, on traverse des futaies serrées, et, tout à coup, on a la surprise délicieuse de déboucher au bord d’un étang, un étang lisse et profond, enclos de tous côtés par les bois, si loin de toutes choses ! Les sapins poussent dans une espèce d’île au milieu ; il faut passer bravement à cheval sur un tronc déraciné qui rejoint les deux rives. Sous les sapins, on allume du feu, même en été, parce que c’est défendu ; on y cuit n’importe quoi, une pomme, une poire, une pomme de terre volée dans un champ, du pain bis faut d’autre chose ; ça sent la fumée amère et la résine, c’est abominable, c’est exquis.
J’ai vécu dans ces bois dix années de vagabondages éperdus, de conquêtes et de découvertes ; le jour où il me faudra les quitter j’aurai un gros chagrin.
* * * * *
Quand, il y a deux mois, j’ai eu quinze ans sonnés, j’ai allongé mes jupes jusqu’aux chevilles, on a démoli la vieille école et on a changé l’institutrice. Les jupes longues, mes mollets les exigeaient, qui tiraient l’œil, et me donnaient déjà trop l’air d’une jeune fille ; la vieille école tombait en ruine ; quant à l’institutrice, la pauvre bonne Madame X..., quarante ans, laide, ignorante, douce, et toujours affolée devant les inspecteurs primaires, le docteur Dutertre, délégué cantonal, avait besoin de sa place pour y installer une protégée à lui. Dans ce pays, ce que Dutertre veut, le ministre veut.
Pauvre vieille école, délabrée, malsaine, mais si amusante ! Ah ! les beaux bâtiments qu’on construit ne te feront pas oublier[1].
Les chambres du premier étage, celles des instituteurs, étaient maussades et incommodes ; le rez-de-chaussée, nos deux classes l’occupaient, la grande et la petite, deux salles incroyables de laideur et de saleté, avec des tables comme je n’en revis jamais, diminuées de moitié par l’usure, et sur lesquelles nous aurions dû, raisonnablement, devenir bossues au bout de six mois. L’odeur de ces classes, après les trois heures d’étude du matin et de l’après-midi, était littéralement à renverser. Je n’ai jamais eu de camarades de mon espèce, car les rares familles bourgeoises de Montigny envoient, par genre, leurs enfants en pension au chef-lieu, de sorte que l’école ne compte guère pour élèves que de filles d’épiciers, de cultivateurs, de gendarmes et d’ouvriers surtout ; tout ça assez mal lavé.
Moi, je me trouve dans ce milieu étrange parce que je ne veux pas quitter Montigny ; si j’avais une maman, je sais bien qu’elle ne me laisserait pas vingt-quatre heures ici, mais papa, lui, ne voit rien, ne s’occupe pas de moi, tout à ses travaux, et ne s’imagine pas que je pourrais être plus convenablement élevée dans un couvent ou dans un lycée quelconque. Pas de danger que je lui ouvre les yeux !
Comme camarades, donc, j’eus, j’ai encore Claire (je supprime le nom de famille), ma sœur de première communion, une fillette douce, avec de beaux yeux tendres et une petite âme romanesque, qui a passé son temps d’école à s’amouracher tous les huit jours (oh ! platoniquement) d’un nouveau garçon, et qui, maintenant encore, ne demande qu’à s’éprendre du premier imbécile, sous-maître ou agent voyer, en veine de déclarations « poétiques ».
Puis la grande Anaïs (qui réussira sans doute à franchir les portes de l’École de Fontenay-aux-Roses, grâce à une prodigieuse mémoire lui tenant lieu d’intelligence véritable), froide, vicieuse, et si impossible à émouvoir que jamais elle ne rougit, l’heureuse créature ! Elle possède une véritable science du comique et m’a souvent rendue malade de rire. Des cheveux ni bruns ni blonds, la peau jaune, pas de couleur aux joues, de minces yeux noirs, et longue comme une rame à pois. En somme, quelqu’un de pas banal ; menteuse, filouteuse, flagorneuse, traîtresse, elle saura se tirer d’affaire dans la vie, la grande Anaïs. À treize ans, elle écrivait et donnait des rendez-vous à un nigaud de son âge ; on l’a su et il en est résulté des histoires qui ont ému toutes les gosses de l’École, sauf elle. Et encore les Jaubert, deux sœurs, deux jumelles même, bonnes élèves, ah ! bonnes élèves, je crois bien, je les écorcherais volontiers, tant elles m’agacent avec leur sagesse, et leurs jolies écritures propres, et leur ressemblance niaise, des figures molles et mates, des yeux de mouton pleins de douceur pleurarde. Ça travaille toujours, c’est plein de bonnes notes, c’est convenable et sournois, ça souffle une haleine à la colle forte, pouah !
Et Marie Belhomme, bébête, mais si gaie ! raisonnable et sensée, à quinze ans, comme une enfant de huit ans peu avancée pour son âge, elle abonde en naïvetés colossales, qui désarment notre méchanceté et nous l’aimons bien, et j’ai toujours dit force choses abominables devant elle parce qu’elle s’en choque sincèrement, d’abord, pour rire de tout son cœur une minute après en levant au plafond ses longues mains étroites, « ses mains de sage-femme », dit la grande Anaïs. Brune et mate, des yeux noirs longs et humides, Marie ressemble, avec son nez sans malice, à un joli lièvre peureux. Ces quatre-là et moi, nous formons cette année la pléiade enviée ; désormais au-dessus des « grandes » nous aspirons au brevet élémentaire. Le reste, à nos yeux, c’est la lie, c’est le vil peuple ! Je présenterai quelques autres camarades au cours de ce journal, car c’est décidément un journal, ou presque, que je vais commencer...
Madame X..., qui a reçu l’avis de son changement, en a pleuré, la pauvre femme, toute une journée – et nous aussi –, ce qui m’inspire une solide aversion contre sa remplaçante. En même temps que les démolisseurs de la vieille école paraissent dans les cours de récréation, arrive la nouvelle institutrice, mademoiselle Sergent, accompagnée de sa mère, grosse femme en bonnet, qui sert sa fille et l’admire, et qui me fait l’effet d’une paysanne finaude, connaissant le prix du beurre, mais pas méchante au fond. Mademoiselle Sergent, elle, ne paraît rien moins que bonne, et j’augure mal de cette rousse bien faite, la taille et les hanches rondes, mais d’une laideur flagrante, la figure bouffie et toujours enflammée, le nez un peu camard, entre deux petits yeux noirs, enfoncés et soupçonneux. Elle occupe dans l’ancienne école une chambre qu’il n’est pas nécessaire de démolir tout de suite, et son adjointe de même, la jolie Aimée Lanthenay, qui me plaît autant que sa supérieure me déplaît. Contre mademoiselle Sergent, l’intruse, je conserve ces jours-ci une attitude farouche et révoltée ; elle a déjà tenté de m’apprivoiser, mais j’ai regimbé d’une façon presque insolente. Après quelques escarmouches vives, il me faut bien la reconnaître institutrice tout à fait supérieure, nette, cassante souvent, d’une volonté qui serait admirablement lucide si la colère ne l’aveuglait parfois. Avec plus d’empire sur elle-même, cette femme-là serait admirable; mais qu’on lui résiste; les yeux flambent, les cheveux roux se trempent de sueur… je l’ai vue avant-hier sortir pour ne pas me jeter un encrier à la tête.
Pendant les récréations, comme le froid humide de ce vilain automne ne m’engage guère à jouer, je cause avec mademoiselle Aimée. Notre intimité progresse très vite. Nature de chatte caressante, délicate et frileuse, incroyablement câline, j’aime à regarder sa frimousse rose de blondinette, ses yeux dorés aux cils retroussés. Les beaux yeux qui ne demandent qu’à sourire ! Ils font retourner les gars quand elle sort. Souvent, pendant que nous causons sur le seuil de la petite classe empressée, mademoiselle Sergent passe devant nous pour regagner sa chambre, sans rien dire, fixant sur nous ses regards jaloux et fouilleurs. Dans son silence nous sentons, ma nouvelle amie et moi, qu’elle enrage de nous voir « corder » si bien.
Cette petite Aimée – elle a dix–neuf ans et me vient à l’oreille – bavarde comme une pensionnaire qu’elle était encore il y a trois mois, avec un besoin de tendresse, de gestes blottis qui me touche. Des gestes blottis ! Elle les contient dans une peur instinctive de mademoiselle Sergent, ses petites mains froides serrées sous le collet de fausse fourrure (la pauvrette est sans argent comme des milliers de ses pareilles). Pour l’apprivoiser, je me fais douce, sans peine, et je la questionne, assez contente de la regarder. Elle parle, jolie en dépit, ou à cause, de sa frimousse irrégulière. Si les pommettes saillent un peu trop, si, sous le nez court, la bouche un peu renflée fait un drôle de petit coin à gauche quand elle rit, en revanche, quels yeux merveilleux couleur d’or jaune, et quel teint, un de ces teints délicats à l’œil, si solides que le froid ne les bleuit même pas ! Elle parle, elle parle – et son père qui est tailleur de pierres, et sa mère qui tapait souvent, et sa sœur et ses trois frères, et la dure École Normale du chef-lieu où l’eau gelait dans les brocs, où elle tombait toujours de sommeil parce qu’on se lève à cinq heures (heureusement la maîtresse d’anglais était bien gentille pour elle) et les vacances dans sa famille où on la forçait à se remettre au ménage, en disant qu’elle serait mieux à tremper la soupe qu’à faire la demoiselle, tout ça défile dans son bavardage, toute cette jeunesse de misère qu’elle supportait impatiemment, et dont elle se souvient avec terreur.
Petite mademoiselle Lanthenay, votre corps souple cherche et appelle un bien-être inconnu ; si vous n’étiez pas institutrice adjointe à Montigny, vous seriez peut-être... je ne veux pas dire quoi. Mais que j’aime vous entendre et vous voir, vous qui avez quatre ans de plus que moi, et de qui je me sens, à chaque instant, la sœur aînée !
Ma nouvelle confidente me dit un jour qu’elle sait pas mal d’anglais, et cela m’inspire un projet simplement merveilleux. Je demande à papa (puisqu’il me tient lieu de maman) s’il ne voudrait pas me faire donner par mademoiselle Aimée Lanthenay des leçons de grammaire anglaise. Papa trouve l’idée géniale, comme la plupart de mes idées, et, « pour boucler l’affaire », comme il dit, m’accompagne chez mademoiselle Sergent. Elle nous reçoit avec une politesse impassible, et, pendant que papa lui expose son projet, paraît l’approuver, mais je sens une vague inquiétude de ne pas voir ses yeux pendant qu’elle parle. (Je me suis aperçu très vite que ses yeux disent toujours sa pensée, sans qu’elle puisse la dissimuler, et je suis anxieuse de constater qu’elle les tient obstinément baissés.) On appelle mademoiselle Aimée qui descend empressée, rougissante, et répétant « Oui, Monsieur », et « Certainement, Monsieur », sans trop savoir ce qu’elle dit, pendant que je la regarde, toute contente de ma ruse, et réjouie à la pensée que je vais désormais l’avoir avec moi plus intimement que sur le seuil de la petite classe. Prix des leçons : quinze francs par mois, deux séances par semaine ; pour cette pauvre petite adjointe qui gagne soixante-quinze francs par mois et paie sa pension là-dessus, c’est une aubaine inespérée. Je crois aussi qu’elle a du plaisir à se trouver plus souvent avec moi. Pendant cette visite-là, je n’échange guère que deux ou trois phrases avec elle.
Premier jour de leçon ! Je l’attends après la classe pendant qu’elle réunit ses livres d’anglais, et en route pour la maison ! J’ai installé un coin confortable pour nous deux dans la bibliothèque de papa, une grande table, des cahiers et des plumes, avec une bonne lampe qui n’éclaire que la table. Mademoiselle Aimée, très embarrassée (pourquoi ?) rougit, toussote :
– Allons, Claudine, vous savez votre alphabet, je pense ?
– Bien sûr, Mademoiselle, je sais aussi un peu de grammaire anglaise, je pourrais très bien faire cette petite version-là... on est bien, s’pas, ici.
– Oui, très bien.
Je demande, en baissant un peu la voix pour prendre le ton de nos bavardages :
– Est-ce que mademoiselle Sergent vous a parlé de mes leçons avec vous ?
– Oh ! presque pas. Elle m’a dit que c’était une chance pour moi, que vous ne me donneriez pas de peine, si vous vouliez seulement travailler un peu, que vous appreniez avec une grande facilité quand vous vouliez bien.
– Rien que ça. C’est pas beaucoup ! Elle pensait bien que vous me le répéteriez.
– Voyons, Claudine, nous ne travaillons pas. Il n’y a en anglais qu’un seul article... etc., etc.
Au bout de dix minutes d’anglais sérieux, j’interroge encore :
– Vous n’avez pas remarqué qu’elle n’avait pas l’air contente quand je suis venue avec papa pour demander de prendre des leçons avec vous ?
– Non... Si... Peut-être, mais nous ne nous sommes presque pas parlé le soir.
– Ôtez donc votre jaquette, on étouffe toujours chez papa. Ah ! comme vous êtes mince, on vous casserait ! Vos yeux sont bien jolis à la lumière.
Je dis ça parce que je le pense, et que je prends plaisir à lui faire des compliments, plus de plaisir que si j’en recevais pour mon compte. Je demande :
– Vous couchez toujours dans la même chambre que mademoiselle Sergent
Cette promiscuité me paraît odieuse, mais le moyen de faire autrement ! Toutes les autres chambres sont déjà démeublées, et on commence à enlever le toit. La pauvre petite soupire :
– Il faut bien, mais c’est ennuyeux comme tout ! Le soir, à neuf heures, je me couche tout de suite, vite, vite, et elle vient se coucher après, mais c’est tout de même désagréable, quand on est si peu à son aise ensemble.
– Oh ! ça me blesse pour vous, énormément ! Comme ça doit vous assommer de vous habiller devant elle, le matin ! Je détesterais me montrer en chemise à des gens que je n’aime pas !
Mademoiselle Lanthenay sursaute en tirant sa montre :
– Mais enfin, Claudine, nous ne faisons rien ! Travaillons donc !
– Oui... Vous savez qu’on attend de nouveaux sous-maîtres ?
– Je sais, deux. Ils arrivent demain.
– Ça va être amusant ! Deux amoureux pour vous !
– Oh ! taisez-vous donc. D’abord tous ceux que j’ai vus étaient si bêtes que ça ne me tentait guère ; je sais déjà leurs noms, à ceux-ci, des noms ridicules : Antonin Rabastens et Armand Duplessis.
– Je parie que ces pierrots-là vont passer vingt fois par jour dans notre cour, sous prétexte que l’entrée des garçons est encombrée de démolitions...
– Claudine, écoutez, c’est honteux, nous n’avons rien fait aujourd’hui.
– Oh ! C’est toujours comme ça le premier jour. Nous travaillerons beaucoup mieux vendredi prochain, il faut bien le temps de se mettre en train.
Malgré ce raisonnement remarquable, mademoiselle Lanthenay, impressionnée de sa propre paresse, me fait travailler sérieusement jusqu’à la fin de l’heure ; après quoi je la reconduis au bout de la rue. Il fait nuit, il gèle, ça me fait peine de voir cette petite ombre menue s’en aller dans ce froid et dans ce noir, pour rentrer chez la Rousse aux yeux jaloux.
[1]Le nouveau «groupe scolaire» pousse depuis sept ou huit mois, dans un jardin avoisinant acheté tout exprès, mais nous ne nous intéressons guère, jusqu'à présent, à ces gros cubes blancs qui montent peu à peu : malgré la rapidité (inusitée en ce pays de paresseux) avec laquelle sont menés les travaux, les écoles ne seront pas achevées, je pense, avant l'Exposition. Et alors, munie de mon brevet élémentaire, j'aurai quitté l'École – malheureusement.
Середня оцінка :

2 коментарів :
написав :
viagra,cheap viagra,viagra online without prescription,generic viagra,viagra use,cialis price,cialis,buy generic cialis,cialis,cialis 20mg,

написав :
I\'ve been troubled for several days with this topic. bitcoincasino, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it?

Залишити коментар :


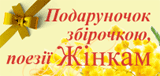

Найважливіше
з теорії детективу!
Знайомтеся з цікавими статтями і доповнюйте рубрику своїми теоріями та практичними історіями. Чекаємо на ваші листи за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com
ОГОЛОШЕННЯ
До уваги передплатників!
Друкована та електронна версії журналу «Дніпро» виходять щомісячно!
Передплатити журнали можна:
на сайті:
www.dnipro-ukr.com.ua;
за телефоном:
(044) 454-12-80;
у відділеннях «Укрпошти».

ЦИТАТА ДНЯ
«Текст – це лише пікнік, на який автор приносить слова, а читачі – сенс»
(Цвєтан Тодоров)

УВАГА!!!
Пропонуємо всім охочим узяти участь у написанні літературно-критичних статей про нобелівських лауреатів.
Чекаємо на ваші роботи про Томаса Еліота до 31 липня 2016 року.
Найкращу статтю буде опубліковано на сторінках журналу.
Роботи надсилайте за адресою: lit-jur-dnipro-zav.proza@kas-ua.com (із позначкою "Нобелівка").